Chlordécone : « Les indemnisations généralisées seraient un précédent insupportable pour l’État »
 14 April 2025
14 April 2025


Le scandale du chlordécone a connu un développement important cette semaine avec le retrait en séance de sa loi d'indemnisation par le sénateur guadeloupéen Dominique Théophile. Alors que le volet pénal est toujours dans l'ornière, depuis le non-lieu rendu en janvier 2023, France-Antilles a rencontré l'auteure d'un livre-enquête paru récemment aux éditions Grasset, " Les Empoisonneurs ". Pour Marie Baléo, " la stratégie de l'État est de rejeter une part de responsabilité sur les planteurs. Une stratégie complètement fallacieuse. "
Le sénateur de Guadeloupe a retiré in extremis sa proposition de loi visant à indemniser les victimes du chlordécone parce que le gouvernement minimise sa responsabilité et refuse de reconnaître les préjudices moral et d'anxiété. Cette position vous étonne-t'elle ?
Non, l'État a depuis longtemps les plus grandes difficultés à reconnaître l'entièreté de sa responsabilité dans le dossier du chlordécone. Sa stratégie consiste, par la voix de gouvernements successifs et notamment au cours des dix dernières années, à qualifier sa responsabilité de partielle. Il s'agit de rejeter une partie de la responsabilité sur les planteurs. Cette stratégie est complètement fallacieuse parce que la protection de la santé relève bien de la responsabilité de l'État, pas de celle des planteurs. C'était à l'État de refuser le chlordécone en 1972 et il y a eu beaucoup d'autres étapes où son utilisation a été prolongée illégalement. Même après son interdiction, l'État est responsable parce qu'il n'a pas organisé la collecte des stocks avant 2002, ce qui fait que les planteurs ont pu continuer à l'utiliser illégalement et en secret. Entre 1999 et 2002, l'État est aussi responsable d'avoir balayé sous le tapis les travaux d'Éric Godard, qui a montré la contamination des sols et des aliments. Dans l'ensemble, l'État a une responsabilité écrasante mais il est très gêné parce que la population est imprégnée à plus de 90 % au chlordécone. Quand on ouvre la boite de Pandore des réparations généralisées, on se pose tout de suite la question de l'indemnisation de 90 % des habitants des deux îles. Et cela, financièrement, pour l'État, c'est impensable. Cela ouvrirait aussi la porte à des indemnisations ici [dans l'Hexagone] de personnes contaminées par des pesticides et ce serait un précédent insupportable.
Pour le sénateur de Guadeloupe, Victorin Lurel, " le crime d'empoisonnement ne pouvait pas prospérer, c'est au contraire la reconnaissance des préjudices moral et d'anxiété " qui constitue la solution la plus vraisemblable pour une indemnisation. Partagez-vous son analyse ?
Je partage totalement son analyse. J'ai toujours trouvé surprenant que l'empoisonnement soit le chef d'accusation avancé par les plaignants parce que cela semble voué à l'échec. Il faut bien reconnaître que le pesticide a été utilisé dans le but de protéger les plantations de bananes et pas le but d'empoisonner les ouvriers agricoles ou la population. L'empoisonnement de la population est une conséquence de cette utilisation mais les planteurs sont tout de même coupables sur le plan moral d'avoir continué à utiliser ce produit même après qu'on a découvert à quel point il était toxique. C'est de l'empoisonnement mais pas au sens où l'entend le droit. Sur le plan juridique, c'est d'ailleurs l'intentionnalité qui a posé problème. Et sur le plan juridique, encore, de mon point de vue, la notion d'empoisonnement ne pourra pas prospérer. Quand on parle d'empoisonnement, l'opinion publique pense aux planteurs mais l'État est aussi mis en cause dans la procédure pénale. Dans ce dossier, l'État comme les planteurs ont fait primer l'intérêt de la filière banane sur toutes considérations sanitaire et environnementales.
Dans votre livre-enquête vous décrivez un système de prédation économique mis en place par de grandes famille békées. Ce système est aujourd'hui encore mis en cause dans le sujet de la vie chère. Chlordécone et vie chère sont liées ?
La pollution de l'environnement au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe rend impossible certaines activités agricoles, d'élevage et de pêche et accroit de facto la dépendance des îles aux importations. Par exemple, le fait que 97 % de la volaille consommée en Guadeloupe soit importée est frappant ! La volaille est très sensible à la contamination au chlordécone. Dans le cas du chlordécone comme dans celui de la vie chère, une poignée d'acteurs économiques a fait primer ses propres intérêts économiques au détriment de l'intérêt général. Les importateurs du produit pesticide sont majoritairement des descendants de colons blancs et les premières victimes de la pollution sont des ouvriers agricoles noirs. La culture sur laquelle a prospéré le chlordécone était une monoculture dans le droit fil de l'économie de comptoir. Plus généralement, l'affaire du chlordécone n'aurait pas pu se dérouler ailleurs qu'aux Antilles parce qu'elle est très marquée par l'histoire coloniale de ces îles. Si cette histoire s'était passée en Bretagne, les conséquences politiques auraient été autrement considérables. L'État traite ses territoires d'Outre-mer comme des territoires de seconde zone.
Related News

Guadeloupe : la Région réagit au feu des perquisitions

MeToo: des députés livrent leurs pistes contre la «machine à broyer» dans la culture
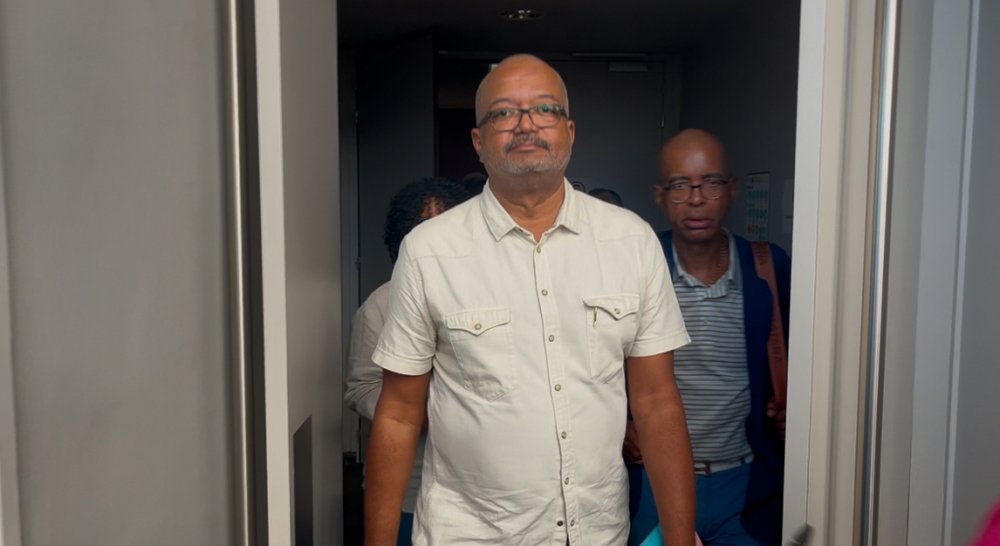
Éric Jalton sera jugé dans six mois, pour une affaire déjà vieille de onze ans

